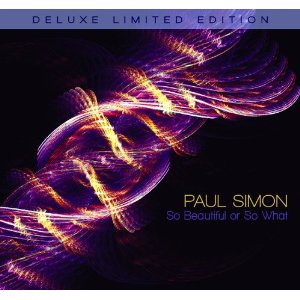
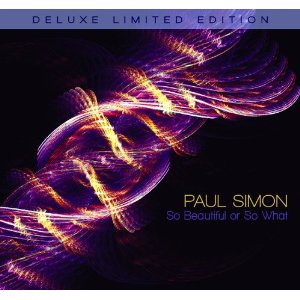
Soyez honnêtes. Qui n’a pas un jour été touché en plein coeur par une chanson de Simon & Garfunkel ? Par ces harmonies vocales angéliques, ces petits miracles de douceur mélancolique et de raffinement que sont “Sound of Silence” ou “Bridge over Troubled Water” ? Le duo n’aura duré que cinq ans, de 1965 à 1970. Les deux hommes se sont parfois retrouvés sur scène, notamment l’été 1981 lors d’un concert historique donné à Central Park devant 500 000 personnes. Mais les chemins de ces amis d’enfance, qui avaient fait leurs débuts lors des fêtes de leur école de Forest Hill, se sont séparés depuis quarante ans. Paul Simon a mieux surmonté le divorce, occupant régulièrement le haut des hit-parades. La deuxième moitié des années 1970 a été plus difficile, mais en 1986 il a triomphé à nouveau avec “Graceland”, réalisé en Afrique du Sud avec des musiciens locaux. Cette ouverture vers les musiques du monde, qu’il confirmera avec ses deux enregistrements suivants, avait en fait été amorcée dès 1972 avec “Mother and Son Reunion”, une chanson de son premier album solo. Et voici qu’avec “So Beautiful or So What” Paul Simon, 69 ans, confirme qu’il demeure un des plus grands songwriters de tous les temps. Ne serait-ce que pour le chef d’oeuvre “Questions for the Angels”, ce disque, lumineuse synthèse d’une vie de chansons, du doo wop de son enfance aux musiques afro-américaines en passant par le folk des années 1960, fera date.…
telerama
« Si on ne meurt pas et qu'on parvient à ne pas sombrer dans l'oubli, on devient une légende vivante », déclarait récemment Paul Simon, faux modeste, comme si son statut rare était à la portée de n'importe qui. Tout le monde n'a évidemment pas écrit des airs qui sont devenus, bien plus que des tubes, des standards universels. Ces chansons, The Sound of silence, Mrs Robinson ou The Boxer, fredonnées et adaptées à travers la planète, Paul Simon les a composées alors qu'il était le moteur et la tête pensante de Simon & Garfunkel, duo folk virtuose aux harmonies célestes qui implosa en 1970.
Depuis, Paul Simon, contemporain de Bob Dylan - il aura 70 ans cette année -, n'a cessé d'avancer, d'enrichir son prodigieux répertoire, d'élargir son champ musical sans frontières. Le plus new-yorkais des auteurs-compositeurs s'est frotté aux cultures d'ailleurs, de la Jamaïque au Brésil en passant par un rendez-vous historique avec l'Afrique du Sud pour son chef-d'oeuvre en solo, Graceland. Avec, comme fil rouge, son don vertigineux pour la mélodie, son chant d'une limpidité inouïe, sa science du texte ciselé, drôle, sensible et brillant. Alors que les 40 ans du monumental Bridge over troubled water se voient célébrés par une luxueuse réédition, Simon publie un nouvel album, So beautiful or so what, qui ne pâtit pas de la comparaison. Rencontre avec une légende vivante, donc.
Cinq ans après Surprise, album expérimental
enregistré avec Brian Eno en 2006, on n'imaginait pas vous voir
revenir avec un album d'une telle fraîcheur et d'une telle vigueur...
Avec le temps, on pense toujours que chaque disque sera le dernier. Et
puis, petit à petit, le processus créatif redémarre.
Cette fois, j'ai repris ma guitare. Je n'avais pas fait ça depuis
longtemps. Avec Graceland, dans les années 1980, je me
suis mis à bâtir mes chansons à partir de schémas
rythmiques. En fait, j'ai retrouvé la manière dont je composais
dans les sixties. A l'arrivée, So beautiful or so what m'apparaît
comme la récapitulation de mon drôle de parcours musical.
“J'ai mis du temps à comprendre
que c'était déjà pas mal
de pouvoir soulager les gens.”
En 1969, vous exprimiez vos doutes sur la nécessité ou
votre capacité à terminer Bridge over troubled
water alors que « le monde était en train de
s'écrouler » - la guerre du Vietnam, notamment, faisait
rage... Vous pensez que les choses vont mieux aujourd'hui ?
Pas du tout. Je pense que le monde est dans un bien pire état
qu'à l'époque. La différence est que je me sens
moins impuissant. Je sais désormais ce que je peux faire, quelle
utilité j'ai. Je ne peux pas changer le monde, mais il semble
que j'ai quand même le don d'écrire des chansons qui font
du bien à certaines personnes. Des chansons sincères, honnêtes,
pas juste des produits commerciaux, qui apportent un écho ou un éclairage à nos
existences. J'ai mis du temps à comprendre que c'était
déjà pas mal de pouvoir soulager les gens.
Votre père était musicien professionnel. Mais
il ne souhaitait pas trop vous voir suivre son exemple...
Ce qui ne fait pas de moi le roi des rebelles pour autant ! Il désapprouvait,
certes, mais ne m'aurait jamais contraint à quoi que ce soit.
Il redoutait que je connaisse la même vie que lui, pas très
reluisante. Toujours dans l'attente d'un cachet, à travailler
chaque week-end et les jours fériés. Ma mère se
retrouvait souvent seule. A 50 ans, il a décidé que ça
suffisait, que ce métier n'en était pas un, qu'il ne rendait
personne heureux, ni lui ni sa famille. Alors, il a repris des études
pour obtenir un doctorat en linguistique. Il a terminé sa carrière
comme professeur d'université, à former d'autres professeurs à enseigner
la lecture... Du coup, je suis allé à l'université moi
aussi, où j'ai étudié la littérature anglaise.
Ma passion était la musique, le rock'n'roll, mais je ne me voyais
pas entrer en conflit avec eux là-dessus.
Ce qui ne vous a pas empêché de percer dans la
musique particulièrement tôt. En 1957, vous décrochez
votre premier succès, déjà avec Art Garfunkel,
sous le nom de Tom & Jerry...
Art et moi étions déterminés. On s'est connus à 11
ans et, instantanément, notre amour commun du rock'n'roll nous
a happés et soudés. Instinctivement, on s'est mis à chanter
ensemble, puis très vite à écrire nos propres chansons.
Aujourd'hui encore, ça me paraît toujours aussi incroyable,
cette assurance, cette certitude. Ecrire des chansons me semblait tout à fait
naturel, et comme, dès mes 16 ans, l'une d'elles, Hey, schoolgirl, est
devenue un hit, je me suis dit que j'avais soit une chance immense soit
un vrai don. Je n'avais pas de raison de m'arrêter. Imaginez, vous écrivez
une petite chanson avec votre meilleur ami, vous l'enregistrez, vous
l'entendez à la radio, vous passez à la télé !
Art et moi, on est devenus du jour au lendemain les héros de notre
lycée.

Ensuite, mes études finies, après avoir enregistré un premier album avec Garfunkel, en 1964, qui n'a pas marché, je suis parti à Londres me nourrir de la scène folk britannique, qui me fascinait. J'ai pu perfectionner mon jeu de guitare auprès de musiciens comme Bert Jansch ou Davey Graham. Alors que j'étais là-bas, le producteur de notre album, Tom Wilson - l'homme qui avait produit les premiers Dylan -, a ajouté un arrangement et une orchestration à The Sound of silence et... je suis rentré aux Etats-Unis pour cinq années de triomphe artistique et commercial ininterrompu avec Art.
“Vous ne pouvez pas imaginer la minutie,
la passion que l'on mettait
dans chaque arrangement, chaque choix d'instrument.
C'était une époque folle...”
On a toujours dit que vous faisiez tout et qu'Art se contentait
de chanter...
Art a beaucoup apporté à mes chansons. Gamins, on écrivait
vraiment à deux, mais, ensuite, j'étais effectivement le
compositeur et l'auteur. Mais il avait une écoute incroyable -
j'avais une confiance totale dans son jugement -, et cette complicité,
cette complémentarité vocale unique que l'on a mis des
années à mettre au point. Au départ, nous nous étions
modelés sur un duo de doo-wop qui s'appelait Robert & Johnny
: l'un chantait le lead, l'autre harmonisait par-dessous. Ensuite, il
y a eu les Everly Brothers, et c'est à partir de là qu'on
a vraiment développé notre style, on a appris à marier
nos voix à la perfection. Nous y passions des heures et des heures,
travaillant chaque mot, chaque son, chaque intonation. Aujourd'hui encore,
pour peu que la voix d'Arty soit en forme - hélas, ce n'est pas
le cas en ce moment -, l'alchimie revient vite.
L'album Bridge over troubled water a marqué l'histoire
de la chanson. Non seulement parce qu'il contient tant de classiques
- la chanson-titre, The Boxer, Cecilia, El cóndor pasa... -,
mais parce que c'est aussi un bijou d'orchestration, d'arrangements,
un vrai travail d'orfèvre...
En tout cas, Roy Halee, qui a travaillé sur tous nos albums de
1966 jusqu'à la fin, n'avait rien à envier à George
Martin, le producteur des Beatles. Une oreille exceptionnelle, un vrai
perfectionniste. J'ai trouvé en lui un jumeau. Il m'a enseigné la
patience, le plaisir d'aller jusqu'au bout d'une idée. Le studio,
avec lui, était un vrai laboratoire. Vous ne pouvez pas imaginer
la minutie, la passion que l'on mettait dans chaque arrangement, chaque
choix d'instrument. C'était une époque folle... Derrière
les Beatles et les Beach Boys, qui se surpassaient à chaque nouveau
disque, il y avait un devoir de faire sinon mieux, au moins aussi fort.
En 1970, Simon & Garfunkel se séparent, fâchés,
brouillés, comme les Beatles. C'est vraiment la fin d'une ère...
Dans les sixties, tous ces artistes formaient une communauté assez
resserrée qui s'observait, s'épiait. Je ne les connaissais
pas tous bien à l'époque, mais, avec le temps, on a fini
par se croiser, se rapprocher... comme des anciens combattants. Les Beatles,
les Stones, Dylan, les Beach Boys et nous... On était très
conscients des autres, de ce qu'ils faisaient. Les Beatles rivalisaient
avec les Beach Boys, les Stones et Dylan se livraient une étrange
compétition. C'est l'époque où Dylan aurait dit à Keith
Richards : « J'aurais pu pondre Satisfaction, mais
vous, vous n'auriez jamais été capables d'écrire Like
a rolling stone. » On avait tous à peu près
le même âge, l'émulation et la rivalité étaient
intenses. C'était vrai aussi au sein même des groupes, entre
moi et Garfunkel comme chez les autres. C'est ça qui a mené à l'explosion
: les conflits d'ego et la pression insupportable de faire toujours mieux.
Je savais, après Bridge over troubled water, que l'on
ne pourrait pas se surpasser. C'est pour ça qu'il n'y a jamais
eu de nouvel album de Simon & Garfunkel. Il fallait que je suive
ma propre route.
“Art et moi étions inondés
de lettres haineuses sur le registre de
‘L'Amérique, on l'aime ou on la quitte‘”
On a gardé de vous l'image de deux gentils garçons
propres sur eux. Pourtant, à l'époque, en Amérique
notamment, vous suscitiez, par vos textes, des réactions très
hostiles, vous étiez même considérés comme
des traîtres...
En fait, il y a eu cette émission spéciale à la
télé, Songs for America, dans laquelle on déplorait à quel
point l'Amérique s'était éloignée des principes
et des idéaux qui l'avaient fondée. Les interventions au
Vietnam ou en Amérique du Sud... Art et moi étions inondés
de lettres haineuses sur le registre de « L'Amérique, on
l'aime ou on la quitte ». Notre discours humanitaire était
considéré comme antipatriotique. Sinon, on n'a jamais eu
une image de rockers décadents, mais ça nous arrangeait
bien. Parce que nous n'étions pas en reste côté excès.
Du coup, on était tranquilles ! Je ne pense pas qu'on avait une
image clean non plus, juste pas d'image du tout. On ne savait rien de
nous. Il n'y avait que la musique et les chansons.

Dans le Connecticut en mars 2011.
Photos: Henry Leutwyler pour Télérama
Elvis et Dylan, des modèles ou des antimodèles
?
Tant qu'il était aux studios Sun, à ses tout débuts,
Elvis était mon idole absolue. Pour autant, je me souviens m'être
dit, à l'âge de 14 ans, qu'il serait impossible de lui arriver à la
cheville et m'être juré du coup de m'exprimer dans un style
le plus éloigné possible du sien. Je n'ai jamais voulu être
un imitateur. Quand Dylan est arrivé, il s'est passé la
même chose. Je n'ai jamais compris tous ces artistes qui ont fait
du sous-Dylan. Bob Dylan est l'homme qui a fait basculer la pop, au niveau
du texte, dans l'âge adulte. Tout comme les Beatles pour le son.
C'était de loin les plus intéressants et novateurs. Mais
il n'était pas question pour moi de copier l'un ou les autres.
De toute manière, Dylan et moi, même si on a le même âge,
nous venons de deux cultures très différentes. Je sors
d'un environnement urbain, j'ai grandi en entendant à la radio
des musiques urbaines. Dylan, lui, est le pur produit d'une petite ville
du Midwest. Son modèle était Woody Guthrie. Moi, je me
suis nourri à la source des Everly Brothers, de Sam Cooke...
Vous avez déclaré n'avoir assumé votre
statut d'artiste que la quarantaine passée. Jusque-là,
vous étiez très mal à l'aise avec ce terme...
C'est venu avec Graceland, il me semble. Mais ce rapport particulier
au statut d'artiste remonte à mon éducation, à l'environnement
dans lequel j'ai grandi. J'étais le plus branché de ma
bande parce que mon père était musicien. Les autres parents,
comme ceux d'Art, étaient des comptables, des commerciaux, des
commerçants. Mes deux oncles étaient bouchers. Mais mon
père ne se considérait absolument pas comme un artiste.
Comme tous ceux qui avaient grandi pendant la Dépression, il travaillait
pour gagner sa vie et c'est tout. Plombier ou musicien, c'était
pareil, on espérait juste qu'on aurait besoin de vous. Se prétendre
artiste était prétentieux. Moi, je n'ai accepté l'idée
que le jour où j'ai compris qu'être artiste n'impliquait
pas forcément d'avoir du talent. Ce n'était que la définition
d'un certain tempérament : on ne peut s'empêcher de créer,
d'inventer. Comme un besoin irrépressible.
“J'ai l'impression d'être plus proche
que je ne l'ai jamais été de mes sentiments,
de mes émotions. Ce qui compte
devient enfin évident.”
Ces concerts que vous faites régulièrement avec
Garfunkel sont-ils un besoin de revisiter le passé pour mieux
vous projeter dans le présent ?
C'est assez étrange, effectivement. Je ne vois pas qui d'autre
fait la même chose. Pour Paul McCartney, ce n'est pas une option,
vu que les deux autres, John et George, sont définitivement indisponibles.
Mais je sais que s'ils étaient encore tous en vie les Beatles
auraient rejoué ensemble. Ils n'auraient pas pu résister.
Le défi, la tentation, l'attraction sont trop puissants. Tant
que la voix d'Art tiendra le coup, je peux reprendre ce répertoire
des sixties qui paraît intemporel, toujours vivant, pertinent.
So beautiful or so what est le titre de l'album et
d'une chanson. On dirait une devise ou une épitaphe...
C'est la dernière chanson que j'ai écrite pour l'album.
Mais lorsque j'ai pris mon carnet au début de ce projet, ce sont
les premiers mots qui me sont venus : « La beauté absolue,
ou à quoi bon ? » Il y a beaucoup d'amour dans ce disque.
Je réalise que j'ai la chance d'être particulièrement
heureux depuis plus de vingt ans. C'est un sentiment qui croît
avec l'âge. Peut-être qu'un jour ça s'évapore,
qui sait ? Mais j'ai l'impression d'être plus proche que je ne
l'ai jamais été de mes sentiments, de mes émotions.
Ce qui compte devient enfin évident. Quand on est jeune, notre écriture
est forcément plus maladroite. D'abord parce qu'on ne maîtrise
pas encore la technique. Surtout, on manque d'expérience, on n'a
pas assez vécu. On est persuadé que nos idées sont
neuves et fraîches, elles le sont rarement. Mais c'est normal d'être
arrogant et prétentieux quand on est jeune. A un âge avancé, ça
devient pathétique. Et impardonnable.